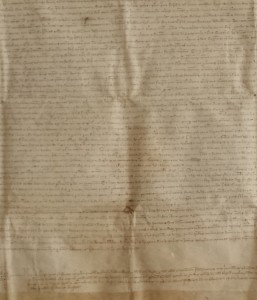« Il ne connut pas les canaris à soupe inépuisable, compétée au bon gré des hauteurs d’une monnaie, d’un os de bœuf, d’une moelle, d’un paquet de légumes. Ces soupes avec le temps se muaient en une mangrove de saveurs (…)
 Fragments d’introduction à la culture créole, à la langue de création, de douceur et de fidélité de Patrick Chamoiseau. Ces passages parlent, et nous parlent, de la cuisine extérieure de la case, là ou les « manmans » cuisinaient, rivalisaient, chantaient. Des passages qui nous mettent dans les pas du sage, comme beaucoup d’autres, car chaque page de ce livre recèle un trésor de langue.
Fragments d’introduction à la culture créole, à la langue de création, de douceur et de fidélité de Patrick Chamoiseau. Ces passages parlent, et nous parlent, de la cuisine extérieure de la case, là ou les « manmans » cuisinaient, rivalisaient, chantaient. Des passages qui nous mettent dans les pas du sage, comme beaucoup d’autres, car chaque page de ce livre recèle un trésor de langue.
Une collaboration signée NecPlus.
Voir aussi Schulz et Bachelard sur la maison, et Proust sur les petites madeleines.
« Cette division de la cuisine et du logement, bien de culture créole, visait à protéger la case des incendies. Le négrillon ne connut pas cette époque où les manmans cuisinèrent côte à côte dans ces pièces, séparées par des cloisons de bois. Il ne connut pas les cérémonies d’allumage du charbon ou d’entretien d’une braise éternelle. Il ne connut pas les canaris à soupe inépuisable, compétée au bon gré des hauteurs d’une monnaie, d’un os de bœuf, d’une moelle, d’un paquet de légumes. Ces soupes avec le temps se muaient en une mangrove de saveurs, capable d’alimenter les énergies de tout le monde (monde avec dents ou monde sans dents). Il imagine la vapeur épicée troublant ces pièces où les manmans mettaient dehors leurs talents culinaires. Elles rivalisaient d’audaces afin de parfumer les saumures du poisson, faire lever d’odorantes fritures, mieux transmettre à l’univers qu’il y avait de leur côté, ce jour là, non pas une misérable sauce de morue mais une tranche de viande-bœuf. Il suppose qu’en plus, elles chantaient, ou dialoguaient à travers les cloisons juste avant d’emporter leur canari dans l’escalier grinçant, vers une marmaille affamée par l’école, et vers les hommes affairés à leur punchs en compagnie du soiffeur de midi, expert en cette visite exacte.
« Dans l’utilisation des cuisines extérieures, les risques étaient nombreux, révèle la haute confidente. On y perdait ses piments. Une telle qui avait besoin d’huile, s’y servait bien en large. Perdre un bout de viande n’y était point rare si quelque urgence vous éloignait là-haut. Les dérobeurs étaient des chats ou d’autres existences plus ou moins proches de l’humanité . On les maudissait en babillages étalés sur des mois, accusant sans jamais les nommer, des ressemblances à telle ou telle voisine, car il est sûr que le nègre restera toujours le nègre et que – déchirée ? – négresses et chiens sont prompts à te haler…
« Quand le négrillon survint, les cuisines étaient mortes. Elles servaient au recel des choses dont l’utilité n’émergeait qu’à l’urgence des déveines. Certaines familles les utilisaient comme salle d’eau. Les Grands y passaient des heures savonneuses et chantantes. Man Ninotte fut, semble-t-il, la première à transformer sa cuisine en poulailler. Cela se produisit sans doute à l’occasion de la visite d’une commère de campagne effectuant son rond annuel en ville. Cette dernière avait dû débarquer dans ses linges d’amidon, chargée selon les rites d’herbes-à-tous-maux, d’ignames, et, sans doute, de deux petits-poussins recueillis dessous un bas de bois. Man Ninotte avait placé ses poussins dans la cuisine, les avait nourris de maïs et d’une poussière de pain d’épices. Les petits-poussins ayant grandi, elle avait dû en faire un dimanche de festin, autour du vermouth des baptêmes et d’un bouquet de fleurs fraîches parfumant la maison. On avait dû trouver cela bien doux et dès l’aube du lundi, Man Ninotte avait dû s’enquérir de deux autres petits-poussins ».
Source : Patrick Chamoiseau, Une enfance créole I, Antan d’enfance, Folio, 1996. Pages 51 et suivantes