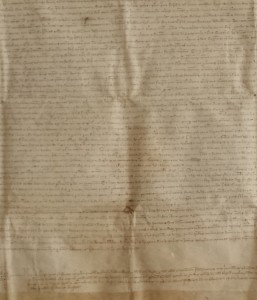» (…) ce n’est pas une objection à sa possible splendeur que d’affirmer l’impossibilité de la tâche du traducteur. Bien au contraire, ce caractère lui prête la plus sublime des filiations et nous laisse entrevoir qu’elle a un sens. »
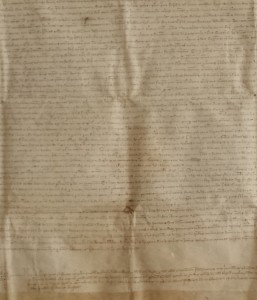 En maniant le paradoxe et l’ironie, José Ortega y Gasset a souligné, dans un texte en forme de dialogue entre savants, l’impossibilité de la traduction et, à la fois, son absolue nécessité. Texte inspiré, semble-t-il, par l’insatisfaction qu’il a ressentie face à la traduction française de son ouvrage le plus connu, « La révolte des masses« .
En maniant le paradoxe et l’ironie, José Ortega y Gasset a souligné, dans un texte en forme de dialogue entre savants, l’impossibilité de la traduction et, à la fois, son absolue nécessité. Texte inspiré, semble-t-il, par l’insatisfaction qu’il a ressentie face à la traduction française de son ouvrage le plus connu, « La révolte des masses« .
Sur ce sujet voir aussi « Littérature : la traduction, vivre entre les langues » et « Cervantes sur la traduction ».
» (…) il est utopique de croire que deux vocables appartenant à deux langues différentes, et que le dictionnaire nous donne comme équivalents, se réfèrent exactement au même objet. Les langues étant formées dans des environnements différents et au vu d’expériences distinctes, cette inadéquation est naturelle. Il est faux par exemple de supposer que le mot bosque se rapporte à ce que l’allemand appelle Wald, et pourtant, le dictionnaire nous dit que Wald signifie bosque.
« Les contours des deux significations ne coïncident pas, telles les photographies de deux personnes en surimpression. Et si dans ce dernier cas notre vue hésite et se brouille sans parvenir à définir l’un ou l’autre des contours ni à en imaginer un troisième, songez à la pénible impression de vague que nous laissera, à nous qui subissons ce phénomène, la lecture de milliers de mots. Ce sont donc des causes identiques qui produisent, dans l’image visuelle et dans le langage, le phénomène du flou. La traduction, c’est le flou littéraire permanent, et comme, par ailleurs, ce que nous avons coutume d’appeler sottise n’est autre chose que le flou de la pensée, ne nous étonnons pas qu’un auteur traduit nous paraisse toujours un peu sot » (P. 13 et 15)
« Aux yeux du mauvais utopiste comme du bon, il est souhaitable de corriger la réalité naturelle qui confine les hommes dans l’enceinte des différentes langues, leur interdisant ainsi la communication. Le mauvais utopiste pense que dans la mesure où ce dessein est souhaitable, il est possible, et de là à le croire facile, il n’y a qu’un pas. Fort de cette conviction, il ne réfléchira pas à deux fois à la manière de traduire, mais il s’attèlera sans plus attendre à son ouvrage. Voilà pourquoi presque toutes les traductions réalisées jusqu’ici sont mauvaises. Le bon utopiste, au contraire, pense que dans la mesure où il est souhaitable de libérer les hommes de la distance imposée par les langues, il est improbable que l’on puisse y arriver ; et que par conséquent on peut seulement y parvenir de manière approximative. Mais cette approximation peut être plus ou moins grande…. de zéro à l’infini, et ceci ouvre à nos efforts un champ d’action illimité qui laisse toujours place à l’amélioration, au dépassement, au perfectionnement -en un mot, au « progrès ». C’est en de telles entreprises que consiste toute l’existence humaine. » (P.23)
« Vous le voyez bien, ce n’est pas une objection à sa possible splendeur que d’affirmer l’impossibilité de la tâche du traducteur. Bien au contraire, ce caractère lui prête la plus sublime des filiations et nous laisse entrevoir qu’elle a un sens. » (P.25)
» (…) chaque langue est une équation différente de déclarations et de silences. Chaque peuple, en effet, tait certaines choses pour pouvoir en exprimer d’autres. Car le tout serait indicible. D’où l’énorme difficulté de la traduction : celle-ci consiste à essayer de dire dans une langue précisément ce qu’elle tend à passer sous silence. Mais en même temps on entrevoit ce que l’activité de traduire peut avoir de magnifique : la révélation des secrets mutuels que les peuples et les époques gardent réciproquement et qui contribuent tant à leur dispersion et à leur hostilité; en somme une audacieuse réunion de l’Humanité. (P.43)
« L’essentiel en la matière à été dit il y a plus d’un siècle par l’aimable théologien Schleiermacher dans son essai Des différentes méthodes de traduire (Paris, Le Seuil,1999). D’après lui, la version est un mouvement que l’on peut tenter dans deux directions opposées : soit on tire l’auteur vers le langage du lecteur, soit on pousse le lecteur vers le langage de l’auteur. Dans le premier cas nous ne traduisons pas à proprement parler : nous faisons, en toute rigueur, une imitation ou une paraphrase du texte original. Ce n’est que lorsque nous arrachons le lecteur à ses habitudes langagières pour l’obliger à évoluer dans celles de l’auteur qu’il y a véritablement traduction ». (P59)
« Il est clair que le public d’un pays n’apprécie pas une traduction adaptée au style de sa propre langue. Pour cela, il a assez de la production des auteurs autochtones. C’est l’inverse qu’il apprécie : qu’en poussant les possibilités de sa langue jusqu’aux limites de l’intelligible, on y fasse transparaître les façons de parler propres à l’auteur traduit ». Les traductions allemandes de mes livres en sont un bon exemple. En quelques années, on en a publié plus de quinze éditions. Ce fait serait inconcevable si on ne l’attribuait pour les quatre cinquièmes a la réussite de la traduction. Et, en effet, ma traductrice a forcé à l’extrême la tolérance grammaticale de la langue allemande pour transcrire précisément ce qui n’est pas allemand dans ma manière d’écrire. De cette façon, le lecteur adopte aisément une tournure d’esprit proprement espagnole. Ainsi, il se délasse un peu de lui-même, et cela le divertit de se retrouver autre pour un instant. » (P.71 et 73)
« La traduction n’est pas un double du texte original ; elle n’est pas, elle ne doit pas vouloir être l’œuvre même dans un lexique différent. J’irais jusqu’à dire que la traduction n’appartient pas au même genre littéraire que le texte traduit. Il conviendrait d’insister sur ce point, et d’affirmer que la traduction est un genre littéraire à part, différent des autres, avec ses normes et ses objectifs propres. Et ce pour la simple raison que la traduction n’est pas l’œuvre mais un chemin vers l’œuvre ». (P61)
Source : José Ortega y Gasset, Misère et splendeur de la traduction, Les belles lettres, 2013 (première édition en espagnol in journal La Nación en 1937).