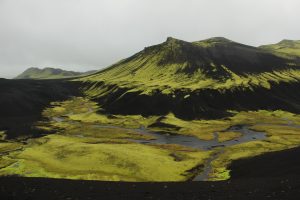« … il se détourne comme nous, plein d’horreur, de ce pandémonium de fureur et de haine qui ébranle sa patrie et l’humanité »

On dit parfois que l’histoire ne se répète pas mais qu’elle bégaie. A lire ce que Stefan Zweig raconte de l’époque de Montaigne et des Guerres de Religion on a l’impression d’être de nos jours en plein bégaiement de l’histoire.
Voir aussi Ricoeur sur la violence ; Nietzsche sur jeunesse et explosion; Hobbes dur sécurité; Freud sur liberté, société et culture; freud sur la guerre; Einstein sur la guerre
» Que malgré sa lucidité infaillible, malgré la pitié qui le bouleversait jusqu’au fond de son âme, il ait dû assister à cette effroyable rechute de l’humanité dans la bestialité, à un de ces accès sporadiques de folie qui saisissent parfois l’humanité, comme celui que nous vivons aujourd’hui, c’est là ce qui fait la tragédie de la vie de Montaigne. (…) Quand il ouvre les yeux sur le monde et quand il s’en sépare, il se détourne comme nous, plein d’horreur, de ce pandémonium de fureur et de haine qui ébranle sa patrie et l’humanité » (p.20)
« En de telles époques où les valeurs les plus hautes de la vie, où notre paix, notre indépendance, notre droit inné, tout ce qui rend notre existence plus pure, plus belle, tout ce qui la justifie, est sacrifié au démon qui habite une douzaine de fanatiques et d’idéologues, tous les problèmes de l’homme qui ne veut pas que son époque l’empêche d’être humain se résument à une seule question : comment rester libre? Comment préserver l’incorruptible clarté de son esprit devant toutes les menaces et les dangers de la frénésie partisane, comment garder intacte l’humanité du coeur au milieu de la bestialité ?Comment échapper aux exigences tyranniques qui veulent m’imposer l’Etat, L’Eglise ou la politique ? Comment protéger cette partie unique de mon moi contre la soumission aux règles et aux mesures dictées du dehors ? Comment sauvegarder mon âme la plus profonde et sa matière qui n’appartient qu’à moi, mon corps, ma santé, mes pensées, mes sentiments, du danger d’être sacrifié à la folie des autres, à des intérêts qui ne sont pas les miens ? » (p.23)
Source: Stefan Zweig, Montaigne, PUF Quadrige 2016.